|
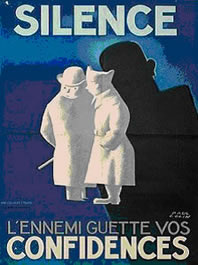
|
L’aide
aux personnes persécutées et pourchassées en France
pendant la Seconde Guerre Mondiale : une forme de résistance.
Gautier
Alvarez, Stéphane Lapeyre, Julien Rossetti, Kevin Larrede
Nous tenons à remercier :
Madame Lapeyre
qui nous a permis de recueillir des témoignages oraux,
Les témoins
pour leur disponibilité et leur simplicité,
Le personnel du
Musée de la Résistance des Hautes Pyrénées
qui a facilité nos recherches en mettant à notre disposition
ouvrages et autre matériel,
Les résistants
rencontrés lors de la journée du 22 octobre 2007 :
– M. Arguinard
– M. Escouert
– M. Fautoux
– Mme Boucher
– Mme Rivière
et M. Dupart qui
nous a guidés lors de la visite du Musée et nous a raconté
son engagement dans le maquis du Vercors,
Madame Sarrelabout
et Madame Cazaux
I
– La situation en France en 1940
Quelques
semaines après le début de l’offensive allemande,
lancée le 10 mai, la France voit ses armées écrasées
: l’Armée du Nord est encerclée, l’Armée
du Centre est dépassée ; la ligne Maginot espoir défensif,
réputée imprenable, tournée sans avoir servi à
rien. Le 14 juin les Allemands entrent à Paris, le 20 ils sont
à Brest, le 22 à La Rochelle, à Lyon... le gouvernement
désemparé se replie à Bordeaux... on envisage l’abandon
du pays et la continuation de la lutte outre mer... mais l’impuissance
de l’Etat est totale, ses moyens réduits à néant.
La France est envahie. Le président du Conseil : Paul Reynaud,
est contraint de démissionner.
Le maréchal Pétain forme alors un nouveau gouvernement,
demande un armistice qu’il signe le 22 juin.
En 5 semaines la France a perdu 92 000 hommes. Le pays est coupé
en deux :
- Au Nord,
de la ligne de démarcation les 2/3 de son territoire sont occupés
par les Allemands ;
- Au Sud, l'État Français est confié à Pétain.
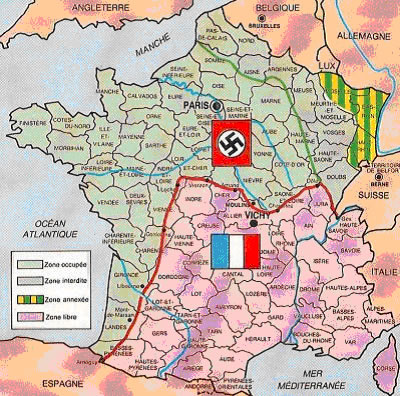
Cet
armistice n’est autre qu’un pacte de collaboration : agriculture,
économie, justice, police, administration, toutes les ressources
de la France sont mises au service de l’occupant nazi. Ceux qui
s’expriment ou agissent contre ces idées, opposants ou
résistants, sont poursuivis. Nombreux sont arrêtés,
torturés, internés dans des prisons ou des camps, fusillés
ou déportés.
De même, certaines catégories de personnes définies
comme « indésirables », font l’objet de mesures
de répression.
II-
Qui sont les pourchassés et les persécutés ?
Plusieurs catégories de personnes sont pourchassées par
le régime nazi et par le régime de Vichy :
1- les réfugiés français et étrangers
Les Alsaciens Lorrains : environ 500 000 évacuent leur région
annexée par le Reich suivis par les Belges et les Luxembourgeois
car le 10 mai 1940, l'armée Allemande a envahi les Pays-Bas,
la Belgique et le Luxembourg, pourtant neutres et poussent des milliers
d’individus à fuir vers la zone libre.
Les Parisiens : Le 10 juin 1940, le gouvernement Reynaud quitte Paris,
déclarée ville ouverte. La capitale est occupée
le 14 juin 1940, c’est l’exode vers le sud
2-
les proscrits du régime
Les Juifs sont poussés par la politique d'extermination des nazis
mais aussi du gouvernement de Vichy.
Le port de l'étoile jaune, les rafles poussent les Juifs français
et étrangers vers la zone sud. Là des organisations d’entraide
se sont mises en place pour leur procurer des papiers, un travail, un
logement… certains rejoignent les organisations de résistance
: « résister, c’est résister pour la survie
de leur peuple ».
Les Francs-maçons et les Communistes sont pourchassés,
arrêtés car politiquement indésirables.
Les réfractaires du STO : le 16 février 1943 une loi impose
le STO. Cette loi permet d'envoyer de force en Allemagne tous les gens
âgés de 20 à 22 ans ; d’abord restrictive,
elle se généralise en 1944 et concerne les hommes de 16
à 60 ans et les femmes sans enfants à charge. Certains
entreront dans la clandestinité et rejoindront les résistants
également pourchassés.
3- Et :
Aviateurs
alliés dont les avions avaient été abattus, Tziganes,
homosexuels…
III-
L’aide aux pourchassés : une forme de résistance
Des hommes, des femmes, des enfants, des familles, français ou
étrangers, ont été pourchassés et persécutés
pendant la seconde guerre mondiale mais certains ont rencontré
sur leur chemin aide et soutien dans notre département : les
Hautes Pyrénées.
Ces personnes se cachaient chez des familles françaises ou des
réseaux résistants plus particulièrement dans des
lieux retirés, isolés comme à la campagne mais
également en ville. Ceux qui leur venaient en aide risquaient
leur vie comme le montre cette affiche placardée en 1941 au sujet
des aviateurs alliés
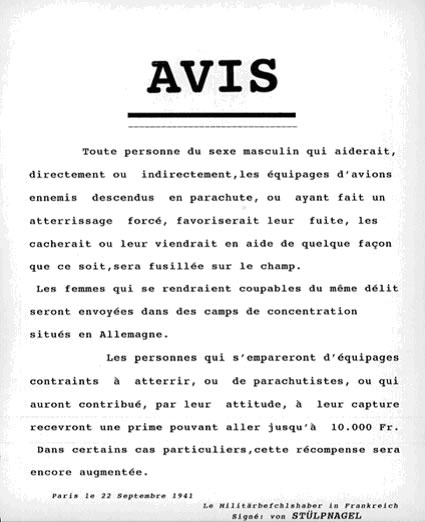
Au
courant des risques encourus, ils ont malgré tout offert leur
aide, portés par diverses motivations, le patriotisme, les valeurs
républicaines, les valeurs chrétiennes, l’humanisme
surtout après les premières rafles (rafle du Vel d’Hiv)
et les représailles contre la population
et la résistance à l’oppression.
Certains
chrétiens n’hésitent pas à réagir.
La
lettre pastorale de Monseigneur Saliège, archevêque de
Toulouse, datée du 23 août 1942, a été reproduite
par « quantité de tracts » selon les renseignements
généraux et parvint en octobre dans les Hautes Pyrénées
où elle trouva un certain écho à Tarbes et à
Lourdes.
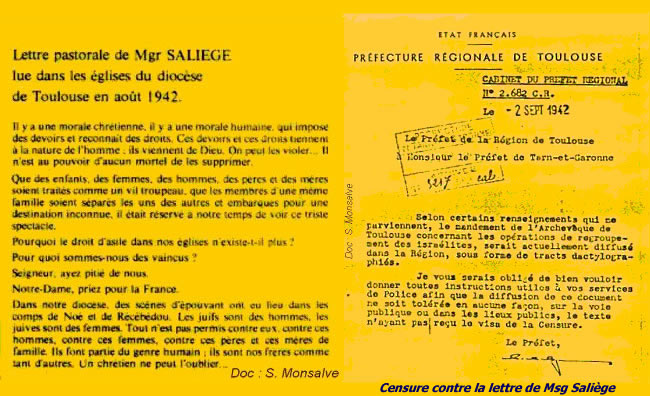
http://adele.kurzweil.site.voila.fr/pages/30saliege.htm
Un
devoir de résistance
Au-delà des circonstances, cet acte est un exemple du devoir
qui s’impose à tout être humain et singulièrement
à tout homme de foi chrétienne, lorsqu’il se trouve
en présence de situations où des populations se trouvent
humiliées, atteintes dans leur dignité humaine, et sans
attendre qu’elles soient persécutées : un devoir
de résistance.
Cela implique une certaine vigilance, une certaine attention à
l’Homme qui forme le sens de tout engagement chrétien,
comme en témoigne l’exemple du Cardinal Saliège.
Certes, à une époque où l’information nous
met quotidiennement en présence de tant de situations dramatiques,
à l’échelle de la planète, le risque existe
que ce devoir de résistance perde de sa vigueur. Il y a par conséquent
une obligation de rappeler aux jeunes générations dont
on sait qu’elles ne manquent ni de coeur ni de générosité
qu’il existe bien pour tout homme un devoir de résistance.
III-
Comment aider les personnes persécutées ?
Le passage à l’action résistante prend multiples
formes plus ou moins organisées, en fonction des situations et
des capacités de chacun à accepter les risques.
1)
LES PASSEURS dans les Pyrénées, les plus connus , ceux
anonymes ou qui ont laissé des témoignages ou qui appartenaient
à des réseaux mais aussi les cheminots qui ont aidé
à franchir la ligne de démarcation même si celle-ci
ne traversait pas notre département.
A)
Dans la zone des montagnes
Les
Hautes Pyrénées constituent une frontière de 90km
avec l’Espagne, d’où l’on pouvait gagner l’Espagne
puis le camp allié, l’Afrique du Nord...
Notre département apparaît donc comme une terre d’accueil
dès 1940 car située en zone libre,
C’est en effet le 11 novembre 1942 que les troupes d’occupation
en provenance de Bordeaux pénètrent dans le département
des Hautes-Pyrénées. Tandis que des détachements
déverrouillent les vallées donnant accès à
l’Espagne, de petites garnisons s’installent à Lourdes,
Tarbes, ou encore Lannemezan.
Les
premières actions de Résistance, souvent individuelles
et peu organisées, consistent à faire franchir ces frontières
de manière clandestine. Malgré la présence de patrouilles
françaises ou allemandes, la surveillance des espaces de campagne
ou de montagne reste imparfaite et les possibilités de passage
sont nombreuses.
Les premiers passeurs sont essentiellement des paysans ou des bergers
qui connaissent bien le terrain, les petits chemins qu’ils utilisent
régulièrement pour leurs activités agricoles ou
pastorales.
L’augmentation de la demande, le resserrement de la surveillance
et les dénonciations de la part des collaborateurs français
à partir de 1942 entraînent la mise en place de réseaux
qui utilisent les services de passeurs bénévoles, mais
aussi de professionnels qui se font payer, mais pour tous le risque
encouru est immense, les embuscades le long des chemins d’évasion
se font de plus en plus nombreuses : 160 passeurs meurent fusillés
ou en déportation.
Emilienne EYCHENNE dans son livre Montagnes de la peur et de l’espérance
a recensé 1724 candidats au passage et 300 seulement ont échoué.
Des juifs persécutés, des aviateurs alliés, des
résistants recherchés, des réfractaires au S.T.O.
... passèrent par les cols pour fuir l'Allemagne, les nazis,
le régime de Vichy ou rejoindre les Forces Françaises
Libres à Londres.
Cette zone frontalière est donc très peu surveillée
jusqu’en 1942 et dès août 1940, dans les onze communes
du département situées sur la frontière, les habitants
servaient de guides à ceux qui souhaitaient la franchir puis
des filières de passage s’organisèrent :

-
À Lourdes, Pierre Desbiaux menait des activités de résistance
et s’occupait de l’organisation du passage de la frontière
vers l’Espagne dans le cadre du réseau Martial. (Le réseau
Martial créé fin 1943 et dont le chef était le
colonel Teyssier d’Orfeuil, alias colonel Martial, avait, entre
autre, pour objectif de fournir des hommes à l’armée
en voie de formation en Afrique du Nord, en passant par l’Espagne)
Il aida de nombreuses personnes (chefs de la Résistance, agents
de renseignements, pilotes alliés…) qui, recherchées
par la police et les Allemands, étaient désireuses de
passer en Espagne.
À ce noyau s’ajoutaient fréquemment des familles
juives, époux, femmes et enfants, fuyant la répression
nazie et le régime de Vichy.
C’est ainsi qu’il fut amené à aider des juifs
à gagner l’Espagne en franchissant les cols des Pyrénées.
Pierre Desbiaux, Juste de France, qui fêtait ses 81 ans le lendemain
de la cérémonie, se souvient avec une émotion intacte
de son action aux côtés de sa mère Marie-Léonie,
Juste elle aussi.
«
Nous avions une pension de famille au 21 de la rue Langelle et nous
hébergions des familles. Nous les savions privés de papiers
d'identité, en attente de faux documents. Je me souviens que
la ville de Lourdes était une ville refuge et de nombreux Israéliens
venaient se cacher. » Ils ne se rendaient pas compte du danger
qu'ils couraient, loin de penser que leur vie était suspendue
à une dénonciation. À peine âgée de
17 ans à l'époque, privé de père dès
l'âge de 3 mois, il résistait à l'ennemi sous les
ordres du chef de la Résistance locale, Roland Cazenave, tandis
que le lieutenant-colonel Teyssier d'Orfeuil, signataire du procès-verbal
de reddition, se cachait dans un bâtiment familial sous les noms
« Montagne » ou « Martial ».En 1944, à
18 ans, il prenait en charge deux familles israéliennes : «
Nous avons eu besoin de quatre nuits entières de marche pour
gagner l'Espagne », se souvient-il. Parfois, ses yeux s'égarent
ou s'activent. Les souvenirs sont toujours là. « Depuis
toujours, je vis dans cette maison familiale. Je me revois là
ou ailleurs, avec celui-ci, celui-là. »
Article publié
dans La dépêche, le 22 janvier 2007
-
Témoignage d’une femme dans la résistance en Barousse
(H-P)
C’est
une française vivant aux Etats-Unis qui en est l’auteur.
La guerre l’a surprise en France, dans le petit village d’Izaourt
en Barousse ; elle n’a pu rentrer aux U.S.A. qu’après
la Libération. Dans sa simplicité, comme s’il s’agissait
d’un simple fait divers, voici ce qu’elle écrit :
«
Française habitant aux U.S.A., je me trouvais dans ma famille
lorsque la guerre éclata. De 1940 à 1942, j’ai vécu
comme tout le monde avec les mêmes soucis, les mêmes difficultés.
Au mois de mars 1942, mon fils, âgé de vingt ans, fut appelé
au S.T.O. Il refusa de partir. Avec trois autres camarades, il passa
en Espagne où la prison le recueillit. A partir de ce moment-là,
beaucoup de jeunes, de toutes parts de France voulurent rejoindre les
F.F.L.De mars à octobre, la vie fut intenable à la maison.
Je ne me sentais plus en sécurité. C’est alors que
Vinal et Barrère de Loures - Barousse me demandèrent de
trouver une « planque » pour y recevoir et former des groupes
de jeunes gens en partance pour l’Espagne ; en quelque sorte,
un centre d’accueil et de dépistage, car les routes de
la Barousse étaient toutes gardées par les Allemands.
Notre lieu de rencontre était au garage Soca à Loures.
D’autre part, je connaissais bien Barrère, né en
Amérique de père français il était rentré
en France à l’âge de dix-sept ou dix-huit ans. Nous
nous rencontrions de temps en temps ; il était heureux de pouvoir
parler anglais avec moi.J’avais une petite maison dans la montagne,
plutôt un abri, quatre murs, un toit, un sol en ciment. A partir
d’octobre 1942, je vécus là avec ma fille. Presque
toutes les semaines, des jeunes gens arrivaient, parfois trente en même
temps. Je les hébergeais, ce qui ne m’empêchait pas
de continuer mon travail : élevage d’un petit troupeau
de moutons qui me servait de couverture et a souvent sauvé notre
vie. Nul dans le pays ne se doutait de rien. Les gens du village voyaient
bien des jeunes gens venir vers ma maison ils s’imaginaient, sans
doute, que c’était pour tout autre chose que la fuite en
Espagne. Je me gardais bien de les en dissuader. Cependant, une plainte
fut portée à la Kommandantur à Luchon. La gestapo
est venue dans la montagne mais, mal renseignée peut-être,
en tout cas, se trompant de chemin elle aboutit au cimetière
! et s’en alla.La seule chose qui comptait pour moi était
de sauver tous ces jeunes que l’on me confiait comme je désirais
que l’on sauvât le mien. Pendant deux ans et demi, j’ai
vécu ainsi avec pas mal de difficultés et une vigilance
constante. J’étais en relation avec Bazerque (Charbonnier)
passeur, Barrère et Sabadie. Ces trois hommes intrépides,
dévoués, ont trouvé la mort à Larroque,
en juin 1944. Il ne restait plus que Vinal pour s’occuper d’une
quarantaine d’hommes en majorité Américains.Le ravitaillement
était assuré dans deux fermes où l’on puisait,
contre paiement, les denrées nécessaires. En hiver, avec
la neige, on cachait les jeunes dans les fermes Puysségur, Pouyfourcat,
à la mairie, à l’école. Celle-ci a brûlé
un jour où probablement une imprudence a été commise.
Fin mai 1944, André Dorbessan, de Loures, m’a présenté,
chez moi, trois Anglais. Ils sont restés huit à dix jours,
puis ont décidé de tenter seuls l’aventure. Nous
les avons accompagnés jusqu’au pied de la montagne de Sost.
Ils ont mis environ trente et une heures pour atteindre l’Espagne.
Ils m’avaient promis de me donner des nouvelles de mon fils, mort
ou vivant. Ils ont tenu parole et, grâce à eux, j’ai
su qu’il vivait.Tous ceux qui passèrent chez moi sont tous
bien arrivés sauf un jeune Serbe mort en montagne en décembre.
»
Article
paru dans la Nouvelle République du 9 octobre 1964
Texte publié dans Résistance - R4 n° 4 - Juin 1978
Les
« passeurs » existent dans chaque vallée.
La filière débute dans les cafés de Tarbes, de
Lourdes… Des appelés au S.T.O. recevaient une adresse qui
leur permettait d’avoir un contact pour passer en Espagne, signe
de la complicité d’une partie de l’administration,
tandis qu’à ALGER, en 1944, on disait que le préfet
des Hautes-Pyrénées aidait les candidats à s’évader
vers l’Espagne.
B) Mais également
LES PASSEURS, (agents de la SNCF) de la ligne de démarcation
bien que celle-ci ne traversait pas notre département.
De nombreux cheminots
à partir de Tarbes, Lannemezan ou Lourdes franchissaient la ligne
de démarcation à Orthez et à Mont de Marsan. Ils
ont été sollicités comme passeurs et ont montré
leur courage en facilitant les transports clandestins d’hommes
qu’ils cachaient dans les machines ou dans un wagon prévu
pour ce genre de transport.
L’un des
agents Germain-André Tixador raconte :
«
[…] on faisait la ligne
Tarbes-Morcenx Il y avait pas mal de prisonniers qui s’évadaient…
En 40, c’était facile de s’évader. On en a
passé une quinzaine avec le mécanicien Diette, à
la ligne de démarcation. Ils étaient en bleu de mécano.
J’ai jamais compris ; on ne demandait pas trop. C’était
un sous-chef de gare de Mont-de-Marsan qui les amenait ; il nous faisait
signe, et l’homme montait. Les Boches arrivaient, regardaient
; ils n’ont jamais demandé pourquoi on était trois
sur la loco. C’était dangereux… mais nul ne songeait
aux dangers de l’action. »
2)
HEBERGEMENT,CAMOUFLAGE ET SAUVETAGE
«
Silence, l'ennemi guette vos confidences ! », c'est ainsi
qu'une affiche placardée sur les murs des villes et villages
de France en automne 1939 appelait les citoyens à se méfier
des paroles prononcées
« au vent » et devant des «
étrangers » (dans le sens de la personne que l'on
ne connaît pas), afin de lutter contre la fameuse «
cinquième colonne » qui devait rassembler en son
sein plusieurs milliers de « nazis français »
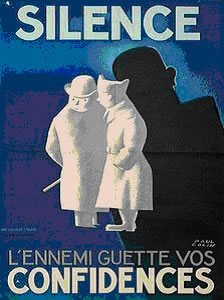
La
première forme d’aide est le silence. La loi du silence
est la première complicité entre persécutés
et résistants.
Parler serait trahir et manquer au devoir de solidarité entre
les habitants du village.
Évidemment, les cas de dénonciations existent. Mais nombreux
sont les exemples de complicités silencieuses.
Dans
le département des Hautes-Pyrénées, certains habitants
ont généreusement ouvert les portes de leur maison pour
la survie de Juifs en détresse pour une nuit ou pour une durée
plus longue. Souvent les Juifs souhaitaient poursuivre leur route vers
l’Espagne et leur hébergement n’était que
temporaire, provisoire. Certains ont séjourné toute la
durée de la guerre dans des villages ruraux grâce à
la complicité de tout le village.
-
Marie et son fils Pierre Desbiaux ont hébergé et caché
des juifs, ainsi que d’autres fugitifs, dans la modeste pension
de famille que tenait Marie à Lourdes.
-
Eugène Sabathier et son épouse ont accueilli, chez eux,
un juif en cavale. Ils se sont occupés de lui pendant un mois,
d’août à septembre 1942 lui procurant toutes nécessités.
-
Charles et Charlotte Soubies ont hébergé la camarade de
classe de leur fille, qui était juive, de novembre 1943 jusqu’en
août 1944, qu’ils traitèrent comme leur fille. Marie
T. Dossier 5116 fut amenée à héberger, dans sa
propre maison, sa jeune voisine. Elle lui permit de se réfugier
dans son appartement, le 11 janvier 1944, alors que les Allemands venaient
pour l’arrêter elle et ses parents. Elle la cacha jusqu’à
la tombée de la nuit malgré la visite des gestapistes.
Ce ne fut que l’aide et l’hébergement d’une
seule journée mais cela lui sauva la vie.
Le fait
de cacher des juifs faisait courir des risques considérables
aux résistants. Les Allemands menaçaient, entre autre,
de brûler les maisons suspectes de cacher des juifs et devant
l’aggravation de la situation, surtout à partir de novembre
1942, certains ont préféré déplacer leurs
protégés en des lieux qu’ils jugeaient plus sûrs.
Dans
le département des Hautes-Pyrénées, des Juifs furent
également cachés au sein d’institutions.
Ce fut notamment le cas de soeur Anne-Marie Llobet qui s’occupa
de placer des enfants, dont elle cachait les parents au sein de son
hôpital, dans des pensionnats de toute la ville de Tarbes, qu’ils
soient religieux ou privés.
-
L’hôpital de Tarbes tenu par un groupe d’hommes et
de femmes, qui, ont risqué leur vie a joué le rôle
d’un véritable lieu d’accueil. Le maire de Tarbes,
Maurice Trélut, maire de 1935 à septembre 1944, date de
sa déportation à Buchenwald, fut le premier maillon de
ce réseau de sauvetage de l’hôpital de Tarbes.
De par sa fonction, beaucoup de personnes s’adressaient à
lui, dont bon nombre de juifs qu’il envoyait à Anne-Marie
Llobet Mère supérieure des Filles de la charité.
Cet hôpital servit de refuge clandestin aux persécutés
et joua un rôle important dans le sauvetage de nombreuses familles
juives.
Des juifs traqués, venant de Pologne, de Roumanie ou d’Allemagne
et qui ne parlaient pas un mot de français étaient catalogués
sourds et muets ou débiles mentaux.
Des résistants blessés ou malades du maquis étaient
également soignés et protégés par les Soeurs
de la Charité, dont Marie-Antoinette Ricard, (soeur Elisabeth)
qui faisaient partie de l’équipe de Marcel Billières,
le directeur. Certains maquisards blessés devenaient ouvriers
agricoles, victimes d’un accident de travail.
Ces
soeurs ont été amenées à mentir non seulement
sur l’identité des malades mais aussi sur les affections
dont ils étaient supposés souffrir, ce qui était
considéré comme un péché par la foi. Pour
leur sécurité, certains étaient hospitalisés
dans le service des contagieux où les Allemands n’osaient
guère mettre les pieds. Marcel Billières, les soeurs Anne-Marie
Llobet et Marie-Antoinette Ricard, et Maurice Trélut ont ainsi
tout mis en oeuvre pour soustraire les juifs des mains allemandes.
-
Les enfants de Lourdes
Lourdes, avec ses hôtels, était un lieu idéal pour
regrouper des enfants et les protéger des bombardements .Vers
l’année 1943, Gérard Piquet était l'un des
2000 enfants, évacués par les Centre-Médico-Scolaires
de diverses villes, sur la ville de Lourdes.
Aujourd'hui il raconte son histoire, et cherche à retrouver ses
camarades.
«
J'avais une dizaine d'années et j'étais l'un de ces enfants
réfugiés dont le nombre devait être d'environ 2000.
Nous étions logés dans des hôtels réquisitionnés.
Beaucoup venaient des villes et des régions de Marseille et Toulon
en prévision d'un débarquement sur les côtes de
Provence. D'autres, comme moi, venaient des villes bombardées
de Bordeaux, Nantes, etc. Les habitants de Lourdes nous avaient très
bien accueillis.
Nous étions sous la surveillance de jeunes adultes que appelions
«
Chef ».
Nous avons appris plus tard, à la Libération de Lourdes,
que certains de ces chefs s'étaient portés volontaires
aux Centres Médico-Scolaires pour fuir le service du travail
obligatoire (STO). Un témoignage que j'ai reçu récemment
m'a précisé que chaque chef était responsable de
trente à quarante enfants, ce qui paraît beaucoup, mais
tous étaient si sages, apeurés, et en manque d'affection,
qu'ils obéissaient et ne causaient aucun trouble. »
Article
publié dans «
La Semaine des Pyrénées » du jeudi 6 novembre 2003
3)
FAUX PAPIERS
Pour
protéger les pourchassés et les persécutés,
il faut leur fournir de faux papiers
En effet, pendant l’Occupation, tout individu doit être
muni de pièces justifiant de son identité pour pouvoir
circuler. Les contrôles étaient fréquents.
Les
maires et les secrétaires de Mairie qui sont aussi souvent des
instituteurs sont sollicités pour délivrer de vrais faux
papiers d’identité.
Le
secrétaire général de la Préfecture, Jacques
Bonis-Charancle procure de fausses cartes d’identité aux
réfractaires du STO, aux résistants.
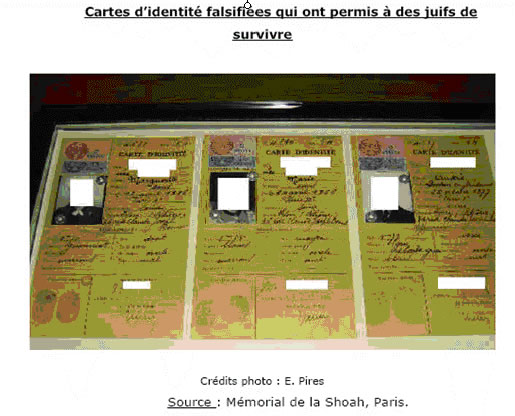

4)
NOURRITURE ET TICKETS DE RATIONNEMENT
En
période de pénurie et rationnement, les aides restent
malgré tout nombreuses, généreuses et souvent spontanées.
Les
boulangers de Saint Laurent (M. Plantat), de Hèches et de Sarrancolin
mais aussi les commerçants, les épiciers et les paysans
fournissent le ravitaillement du maquis.
Les
maires des villages aident également en fournissant des vivres
ou en organisant des collectes auprès des habitants. Ce fut le
cas des maires de Baudéan (M. Isaac), d’Asté (M.
Bérot) pour le maquis d’Antayente et du maire de Nistos
qui fit collecter des pommes de terre et du lard pour les maquisards
réfugiés à la ferme Lacourade à Nistos,
après un jour et demi de diète.
Les
employés de mairie facilitent également le vol de tickets
d’alimentation tout comme certains anonymes :
une femme à Bagnères de Bigorre laisse la clé sous
la porte acceptant ainsi d’être volée ; M. Pomès
responsable du Dépôt du Service de Ravitaillement également
à Bagnères de Bigorre se laisse piller.
5) RENSEIGNEMENTS
Les
femmes ont été souvent de précieux agents de liaison,
de renseignements pour les maquis. Elles ont servi à cacher des
documents ou du matériel. Les femmes permettaient alors l’organisation
de la base logistique de la Résistance.
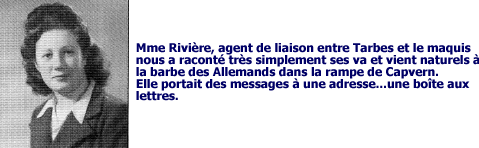
-Témoignage
de Mme Renée Latour
Le 30 mai 1944, Renée Latour se rend comme chaque matin, à
son travail. Elle est secrétaire au garage Peugeot de Lannemezan.La
ville depuis quelque temps déjà, vit sous le joug de l’occupant.
Soudain, les Allemands envahissent les lieux. Elle a été
dénoncée pour faits de résistance. « Je
transportais des plis et recevais du courrier que je distribuais ensuite
en cachette » …
La Nouvelle
République des Hautes Pyrénées, 1995
Elle
fait partie des Mouvements Unis de la Résistance (MUR) et est
donc considérée comme terroriste.
Elle n’a que 21 ans.
Elle est emprisonnée à Toulouse puis déportée.
- Eugène
Sabathier, le soir du 25 août 1942, veille de la grande rafle
de la zone libre, prévint un juif que la gendarmerie s’apprêtait
à lancer une grande rafle de juifs dans la région. Le
juif lui-même prévint, à son tour, d’autres
juifs.
La nuit même, les gendarmes déclanchèrent l’opération.
Eugène Sabathier a ainsi sauvé non pas la vie d’un
seul juif mais de plusieurs en avertissant qu’une rafle se préparait.
À Bagnères-de-Bigorre, le commissaire de police Georges
Vigoureux était connu pour ses activités bénéfiques
à l’égard des juifs.
Les Allemands multipliaient les descentes et les contrôles dans
cette zone où de nombreux réfugiés juifs transitaient
pour passer en Espagne. Toutefois, ils en informaient le commissaire
Georges Vigoureux, qui à son tour, prévenait les personnes
visées, leur permettant ainsi de s’enfuir.
Georges chargeait Jacques Vigoureux, son fils, de prévenir personnellement
les juifs et ceux qui les cachaient avant le début des rafles.
6) CAMOUFLAGE
D’ARMES
La population est amenée à camoufler du matériel
destiné ou appartenant aux maquisards ; ainsi une automobile
appartenant au maquis est cachée dans la maison d’un particulier,
à Nistos.
Les maquisards descendent le soir pour camoufler les parachutages d’armes
dans des fermes « amies ».

7)
EMPLOI
Dans
les Hautes-Pyrénées, on retrouve Marcel Billières,
le directeur de l’hôpital mixte de Tarbes, qui, aida des
juifs en leur offrant un emploi au sein de son établissement.
Également
à Tarbes, Charles Soubies., employa un juif en tant que comptable
dans son entreprise.
L’offre
d’un emploi à un juif et la préservation de leurs
biens furent dans bien des cas, des aides temporaires accompagnées
d’une autre issue mais c’était le début de
la survie, du soutien et de l’entraide.
Témoignage
de Claude Tisney
«
Né le 6 Juin 1922, à Biarritz, j'ai 18 ans au moment de
la débâcle de nos Armées en 1940. Etudiant à
l'Ecole Nationale des Industries Laitières d'Aurillac (Cantal),
je dois passer mes examens de fin d'Etudes en Juillet.
Mais j'apprends par un groupe de Scouts de passage à Aurillac
qu'un embarquement est prévu pour les troupes polonaises, sur
la Côte Basque le 19 Juin.
J'ai pleuré en écoutant la radio, l'annonce du «
cessez le feu » par le Maréchal
Pétain. Ma décision est prise.
Je pars donc, dans le train bondé, pour Toulouse, avec correspondance
possible à St-Jean de Luz.
Retardé en gare de Tarbes par un accident, J'arrive deux heures
trop tard. Les bateaux étaient en mer.
Je rentre à Aurillac et passe mes examens. En Août 1940,
vers le 8, (avec un camarade Belge), résidant moi-même
pas trop loin de Tarbes, je tente à nouveau de partir par l'Espagne
en passant simplement par la gare internationale de Canfranc (64). Hélas!
alors que nous foulions déjà le sol espagnol, repérés
par, les «
Guardias Civiles », nous repartons
pour Pau, menottes aux poignets, encadrés par deux gendarmes
français. Une nuit à la prison. Un directeur bienvei11ant,
qui, le lendemain, nous fait libérer en nous disant: "surtout
ne vous faites pas reprendre".
La leçon ne sera pas perdue. Ensuite, c'est le cursus normal
en zone dite libre : Chantiers de Jeunesse à St-Bertrand de Comminges
(31), puis réquisition par le Service du Travail obligatoire
en Allemagne.
Nous sommes en Juin 1943. Mais depuis ma libération des Chantiers,
le 28 Février 43, j'appartiens à un Groupe de renseignements
de l'Armée Secrète, animé à Tarbes (65)
par le père Félix Etchepare, supérieur de l'Orphelinat
St-Joseph où j'avais été accueilli en 1932, après
la mort de mon père (des suites de la Guerre 14/18, sans pension).
Ma mère n'avait donc pas le choix. Elle était veuve avec
6 garçons: l'aîné 15 ans, le dernier 1 an. - J'en
avais 10. - Il n'existait pas d'allocations familiales.
Le père Etchepare m'avait donc recruté. Après ma
convocation au STO, il m'avait placé comme surveillant des orphelins
à la Maison de Vacances d'Orleix, au début de Juillet
43, avec la complicité du secrétaire de Mairie.
Avec deux autres camarades, nous formions une troïka: notre mission
consistait à vérifier que les caches d'armes des gradés
de l'Armée, en été 19401, n'avaient pas été
découvertes par des miliciens ou certaines gendarmeries.
Au départ, ces emplacements avaient été reportés
sur des cartes d'Etat Major, mais un officier pétainiste s'était
emparé de certaines et les avait communiquées à
Vichy.
Au cours de ces localisations, notre trio en pleine nuit avait été
interpellé par des gendarmes en embuscade et l'un de nous (Lucien),
blessé aux jambes, avait été capturé et
transporté à la prison de Tarbes.
Or, le père Etchepare était aussi aumônier de la
prison, située dans la même rue que l'orphelinat (rue Eugène
Tenot). Renseigné sur l'affaire, le lendemain matin, il s'est
rendu à l'infirmerie de la prison. Notre camarade (Lucien) lui
indiqua qu'il n'avait pas parlé. Par prudence, le père
nous donna à choisir: le maquis dans la montagne ou l'Espagne.
La filière d'évasion passait par l'abbaye de Belloc non
loin de Cambo et le père était un ancien de celle-ci….
[…] »
Bordeaux,
le 11 Janvier 2001
IV-
HOMMAGE
Le Comité Français pour Yad Vashem, fondé en 1989
décerne le titre de Juste des Nations aux non-juifs qui, malgré
les grands risques encourus pour eux-mêmes et pour leurs proches,
ont aidé des juifs à un moment où ils en avaient
le plus besoin. (voir annexe)
16 remises de titres de Juste des Nations ont été effectuées
dans les Hautes Pyrénées au titre individuel ou familial.
Souvent l’aide impliquait toute une famille.
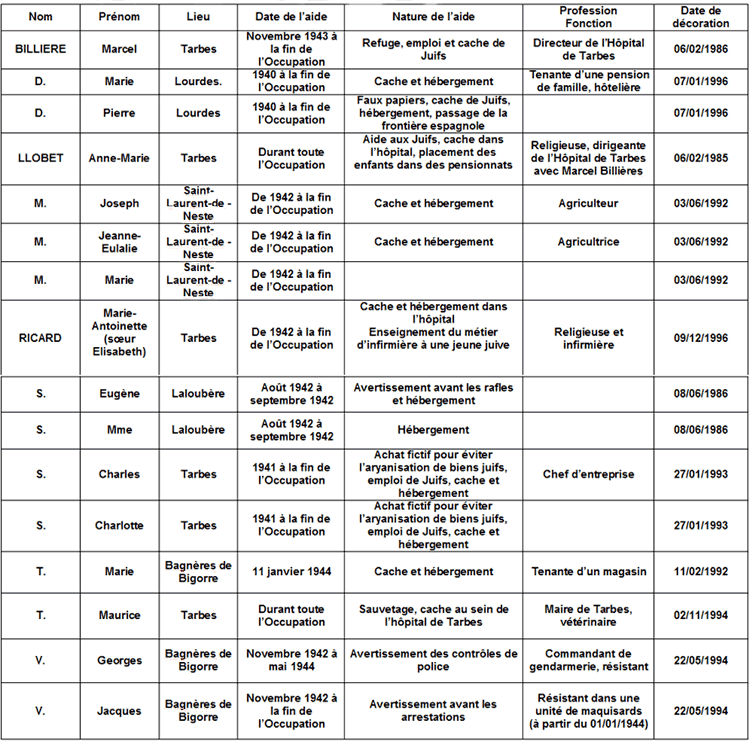
Dans
notre département, d’autres hommages ont été
rendus et le sont encore aujourd’hui à tous ceux anonymes
ou plus connus qui ne rentrent pas dans la catégorie des Justes
mais qui ont participé activement à la résistance
:
- de nombreuses plaques de rue des villes et villages témoignent
que des hommes et des femmes ont mené le combat jusqu’au
sacrifice de leur vie,
- des établissements publics portent le nom de résistants,
- des stèles sont érigées sur les lieux de combats
pour rappeler et ne pas oublier le nom des combattants,
- les monuments aux morts.
Un hommage particulier aux femmes
Beaucoup de femmes s'investirent dans la Résistance sortant du
rôle effacé que leur promettait la société
de l'époque pour sauver leur pays des griffes nazies. La plupart
de leurs actions, bien que stratégiques, furent discrètes
et diffuses.
Les femmes aidaient directement la Résistance en nourrissant
et en hébergeant les alliés parachutés, les résistants
et les maquisards. Les maisons étaient des lieux de résistance
: elles servaient de lieu de réunion, d’écoute ou
de transmission radio.
Toutes ces femmes appartenaient à la Résistance civile.
Beaucoup le payèrent de leur vie en étant déportées,
brutalisées, torturées, violées, fusillées,
massacrées.
Mais à la Libération, la plupart reprirent leur vie là
où elles l'avaient laissée.
Méconnu
ou passé sous silence, le rôle des femmes dans cette période
de l’histoire doit être porté à la connaissance
de tous, dans un souci de justesse historique, mais aussi dans un souci
de justice à l’égard de celles qui trop modestement
donnèrent leur tribut à la libération de la France.
Que ces femmes puissent donc retrouver la place qui leur revient dans
la mémoire collective.
Témoignages audio recueillis :
-
Mme G. d’ Izaux raconte que ces parents ont hébergé
un jeune maquisard blessé du Maquis de Nistos, un jeune étudiant
en médecine.
Le docteur Nau qui soigne ceux du maquis entre en contact avec le docteur
Baratgin. Celui-ci lui indique un hébergement dans « une
maison amie » pour le jeune maquisard. Le jeune sera caché
dans la grange de ses parents et y restera plus d’un mois. Le
docteur Nau venait régulièrement lui faire les pansements
et à la nuit toute la famille allait le voir et jouaient aux
cartes avec lui. La maman de Mme G. lui portait à manger et lavait
son linge.Mme G. âgée de 10 ans allait à l’école
et pour elle le plus difficile était de garder le secret car
on lui avait dit de ne rien dire. Elle avait toujours peur de trahir
par une parole, un mot…
-
Mme. C. de Saint-Laurent-de-Neste étant atteinte de la maladie
d’Alzheimer, c’est son mari qui témoigne de l’histoire
vécue par les parents de son épouse et elle-même.
Les parents de Mme C. sont de simples agriculteurs et ont 5 enfants.
Ils ont vécu la guerre de 1914/1918 et détestent les Allemands.
De plus ce sont des catholiques pratiquants toujours prêts à
aider les autres.Beaucoup de Juifs vivent à Saint-Laurent-de-Neste,
clandestinement soit dans des appartements loués soit logés
gratuitement. C’est donc tout naturellement que les parents de
Mme C. hébergent un premier couple de Juifs, M. et Mme K. dès
1943 dans une cachette aménagée dans la grange. Par la
suite c’est la famille R. qui les rejoint : un couple et ses deux
filles Rosa 16 ans et Lisa 10 ans. A la veillée, tous se réunissent
dans la maison pour passer un moment ensemble.Suite à des dénonciations,
les Allemands effectuaient des descentes dans la maison.Un jour, les
Allemands débarquent chez ses parents et bien renseignés
entrent immédiatement dans la maison fermée, attenante
à la leur. Là où les Juifs viennent passer un moment
de temps en temps.
Les Allemands découvrent un cendrier avec trois mégots
récents. La maman de Mme C. a la présence d’esprit
de se tourner vers son mari et de lui dire : « Je t’avais
bien dit que les filles fument en cachette ! » Les Allemands n’iront
pas plus loin, pourquoi ? Une chance les trois hommes étaient
cachés et dans la rue, un coup de feu retentit …d’autres
Allemands venait de tuer M. Plantat, ils étaient venus pour tuer
des maquisards…
Peu de temps après, les hommes Juifs partent pour l’Espagne
avec des passeurs. Comme tout se passe bien pour eux, ils demandent
à leur famille de les rejoindre par la même filière
avec les mêmes passeurs. Le passage a lieu le 6 juin 1944, ils
sont 23. Arrivés à Chaum, les Allemands les arrêtent,
les passeurs qui avaient été dénoncés, s’enfuient
et Rosa la fille de 16 ans les suit. Ne sachant que faire de cette jeune
fille, il la confie au curé de Fronsac qui lui donne un vieux
vélo et elle reviendra seule, chez sa seule famille, les parents
de Mme C. à Saint-Laurent-de-Neste qui la cacheront jusqu’à
la fin de la guerre. Sa maman et sa jeune sœur sont mortes à
Auchwitz. Son père a réussi à regagner la France.Mme
C., accompagnait Rosa dans les bois où elles restaient cachées
quelquefois plusieurs jours pour échapper aux descentes allemandes.
Le frère de Mme C ; leur portait de la nourriture dans la cabane
qui leur servait de refuge.La médaille des Justes des Nations
sur laquelle est gravée cette phrase du Talmud : « Quiconque
sauve une vie sauve l'univers tout entier » a été
remise aux parents de Mme C . à titre posthume ainsi qu’à
elle-même.
Ces
deux témoignages retracent bien les gestes simples et quotidiens,
le soutien et le réconfort que ces femmes ont apporté
à ceux qui étaient pourchassés ou persécutés,
Juifs ou non-Juifs durant cette période sombre et au péril
de leur vie.
Extrait
du discours sur la résistance en Vallée d’Aure au
congrès de Ravensbrück en octobre 1999
«
Au sein de cette Bigorre résistante, les femmes assumèrent
une grande partie du travail clandestin. Toutes n’étaient
pas membres d’un réseau organisé. Cependant en notre
vallée d’Aure, qui fut lieu de passage pour tous ceux qui
fuyaient le régime nazi, pour les réfractaires au STO,
pour les membres des réseaux, pour les clandestins voulant rejoindre
l’Afrique du Nord pour tous, elles furent celles qui hébergeaient,
cachaient, soignaient en attendant le départ pour traverser la
frontière.Sans oublier que ces femmes, continuaient à
faire vivre la ferme, le commerce, assurer la continuité de la
vie familiale alors que l’absence répétée
du chef de famille se faisait cruellement sentir. Je sais bien que toutes
les régions de France on connu ce rôle des femmes pendant
l’occupation, mais il paraît bon de le rappeler à
une époque ou l’on essaie de banaliser les actes, les propos
fascistes dans notre pays et ailleurs. »
V- CONCLUSION
Qu’est-ce
qui a pu bien pousser ces hommes et ces femmes à risquer leur
vie, mettre en péril celle de leur famille, pour porter secours
à d’autres hommes et femmes pourchassés et persécutés
sous l’Occupation ? Il est difficile de répondre à
cette question.
Prisonniers de guerre évadés, aviateurs alliés
en fuite, résistants pourchassés ou souhaitant poursuivre
le combat hors de métropole, étrangers réfugiés,
Juifs, Tziganes, Francs-maçons, réfractaires au STO, ont
été aidés par de nombreux Français qui risquaient
eux aussi leur vie.
Ces sauveteurs, qui ont souvent payé de leur vie des gestes essentiels
de solidarité et d'humanité, venaient de tous les horizons,
avec des motivations diverses, et n'appartenaient pas forcément
à un mouvement ou un réseau organisé.
Des anonymes, aujourd’hui disparus, ont spontanément secouru
les persécutés.
Ces personnes n’ont rien exigé à l’époque
et n’en demandent pas plus aujourd’hui. C’est avec
naturel et simplicité qu’ils sont allés au devant
des autres, et c’est avec discrétion et modestie qu’ils
continuent leur vie ou appartiennent au passé.
Sans eux l'action de la Résistance aurait été impossible.
Nous nous devons de rendre hommage à leur esprit de solidarité,
leur dévouement, leur aide désintéressée
et ne pas oublier.
«
Justes de la Nation »
L’origine
des « Justes de la Nation » vient du Talmud (traité
Baba Batra, 15b).
Tout
au long des générations, il a permit de désigner
« toutes les personnes non juives ayant manifesté une relation
positive et amicale envers les Juifs ».
«
Et je leur donnerai, dans ma maison et dans mes murs, un mémorial
(Yad) et un nom (Shem) qui ne seront pas
effacés ».
Bible, Isaïe 56.
Devoir
de mémoire et de gratitude, ce titre ancestral vieux de 2.000
ans dans la tradition juive, est appliqué aux hommes et aux femmes
qui sont des amis du peuple juif. Ainsi Cyrus conquérant perse
reçu ce titre lors de sa décision de ramener tous les
déportés des bords du Tigre et de l’Euphrate vers
leur lieu d’origine.
BÉNÉFICIAIRES :
Les
critères de reconnaissance sont :
· Avoir apporté une aide dans les situations où
les « juifs » étaient impuissants, menacés
de mort ou de déportation vers des camps de concentration.
· Que le « sauveteur » était conscient du
péril de sa vie en apportant cette aide, ainsi que de sa sécurité
et liberté personnelle. Cette assistance étant considérée
par les « nazis » comme un délit majeur.
· Que le « sauveteur » ne souhaitait aucune récompense
ou compensation pour son acte.
· Que le sauvetage soit confirmé par les personnes sauvées
ou attestées par des témoins directs, voire des archives
ou documents authentiques.
Les aides sont diverses :
· Héberger un « juif » en sa maison ou des
institutions laïques religieuses, à l’abri du monde
extérieur et de manière invisible pour le public.
· L’aider à se faire « passer » pour
un non-juif en lui procurant papiers d’identité ou certificats
de baptême.
· Les aider à gagner un lieu sûr ou traverser une
frontière vers un pays de sécurité, et aider les
adultes et enfants dans leurs périples sur les territoires occupés.
· Adoption temporaire des enfants « juifs » (durant
la guerre).
CONDITIONS DE CONCOURS :
Les Justes sont des personnes modestes, timides qui ne se manifestent
pas.
Leur
dossier est ouvert suite au témoignage d’un individu qui
a été sauvé.
Cependant
selon les situations géographiques les justes ont agi spontanément.
Mais des différences existent selon la France et la Hollande,
que le pays soit ou non sous occupation allemande ou avec un gouvernement
légal comme la France de Vichy.
Il
est nécessaire de mettre en valeur l’histoire du sauvetage
et de la responsabilité individuelle.
LA
DISTINCTION :
Le
ruban et La médaille

PARTICULARITÉS
:
Constitution
du dossier, trois étapes :
· Le Département des Justes, créé en 1963
en France constitue les dossiers en réunissant écrits
et certifiés de deux personnes juives sauvées.
·
Le dossier est adressé à Yad Vashem (Jérusalem)
où il est examiné par une commission de personnalités
et de réprésentants des organisations de résistants
et de rescapés de la Shoah. Présidée par un juge
de la Cour Suprême.
Minutieusement
examinés les témoignages et documents font parfois appels
à des compléments d’informations.
C’est
la seule instance habilitée à décerner cette plus
haute distinction par l’Etat d’Israël à titre
civil.
·
Acceptation et remise de la médaille.
PROTOCOLE :
Après
l’acceptation du dossier par le Comité Yad Vashem, le Comité
français organise les cérémonies officielles.
Durant
ces dernières, les médailles et diplômes sont remis
aux Justes ou leurs ayant droits par l’Ambassadeur d’Israël
en France, ou par l’un des représentants de l’Ambassade
en présence des autorités civiles, politiques,…
A Jérusalem, l’allée des Justes à Yad Vashem
porte un arbre où se trouve la plaque d’un « Juste
».
Comité
français de Yad Vashem : 64, avenue Marceau 75008 PARIS Tél
: 01.47.20.99.57
http://www.col.fr/yadvashem/comite.html
http://medaille.decoration.free.fr/France/Pays/Israel/P_Medaille/M_Justes.htm
VI
– BIBLIOGRAPHIE
Ouvrages sur l’histoire locale :
BENEZECH Maurice, Résistance en Bigorre, par le Comité
Départemental de la Résistance des Hautes Pyrénées,
Tarbes, Editions Hunault et fils, 1989
EYCHENNE
Emilienne : Montagne de la peur et de l’espérance : le
franchissement de la frontière espagnole pendant la seconde guerre
mondiale dans le département des Hautes Pyrénées,
Toulouse, Privat, 1980
CUBERO
José : Les Hautes Pyrénées dans la guerre 1938-1948,
Editions CAIRN, 2002
Francs
Tireurs et Partisans Français des Hautes Pyrénées
: Ceux du Maquis d’Esparros et de Nistos, ANARC, 1994
Travaux universitaires :
PIRES Estelle : Les Justes parmi les Nations dans le Sud-Ouest: départements
des Landes, Basses et Hautes Pyrénées , Mémoire
de première année de master en histoire contemporaine,
Université de Pau et des Pays de l’Adour, 2005-2006
TILHAC
Nadège : Les Maquis dans le secteur est des Hautes Pyrénées
durant la seconde guerre mondiale, études des relations entre
maquis et population civile et militaire, Mémoire de Maîtrise
d’Histoire Contemporaine, Université de Toulouse Le Mirail,
2000
Témoignages recueillis :
Mme
C. de Saint-Laurent-de-Neste
Mme G. d’Yzaux
Sites Internet :
Chrétiens
et Juifs sous Vichy, 1940-1944sauvetage et désobéissance
http://www.pyrenees-passion.info/georges_adagas.php
http://www.yadvashem-france.org/publications/
http://maquis-nistos-esparros.chez-alice.fr/histoire.php
Mon
réfractariat, récit de Claude TISNEY, 2001
http://www.cheminsdememoire.gouv.fr/page/affichepage.php?idLang=fr&idPage=4786
Les
réseaux des Hautes Pyrénées
diaporamas sur les femmes pendant la guerre
Menu |